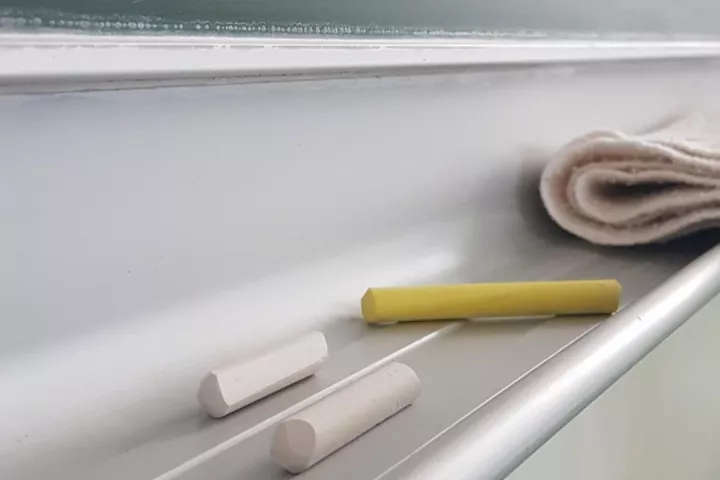Des centaines de postes mis au concours du métier d’enseignant ne sont pas pourvus, plus de 2 500 classes n’ont pas de professeurs… L’Education nationale traverse une crise de recrutement sans précédent. Formation, rémunérations, conditions de travail, stabilité des programmes : une remise à plat s’impose pour que demain tous les élèves aient devant eux un professeur formé et motivé.
Une semaine après la rentrée, il manque au moins 2 500 professeurs titulaires devant les élèves. « Ce sera encore pire dans quelques semaines car il n’y a quasiment pas de remplaçants dans la moitié des académies. Quand des collègues seront malades, en congés maternités ou parentaux, en retraite en cours d’année, les élèves vont se retrouver face à un bureau vide » indique le syndicat UNSA-Education.
Cette année encore, les concours au professorat des écoles et du secondaire (Capes) n’ont pas permis de pourvoir tous les postes proposés. Sur les 27 713 ouverts aux concours du public 2 330 n’ont pas trouvé preneur (9,4%). Contrairement à une idée reçue, le privé n’est pas mieux loti, puisque 336 recrutements n’ont pas trouvé de candidat au niveau minimum requis dans les établissements sous contrat.
La pénurie peut apparaitre moins forte qu’en 2024 (3 165 postes non pourvus). C’est un trompe-l’œil : la baisse de la démographie scolaire et un nombre moindre de départs à la retraite en raison de la réforme de 2023 ont réduit le nombre de postes proposés aux concours externes et internes.
Tous les syndicats de l’Education nationale et les professeurs d’université qui préparent les candidats aux concours et forment les futurs enseignants dressent le même constat : le métier de professeur n’attire plus.
Dans le secondaire, les mathématiques, la physique-chimie et les Lettres sont encore plus en souffrance depuis que la réforme Blanquer a rendu ces matières optionnelles au lycée.
Les raisons sont connues et clairement énoncées dans deux rapports, l’un de la Cour des Comptes, l’autre des services du ministère de l’Education nationale : rémunérations trop faibles, manque de reconnaissance, formation insuffisantes, instabilité des missions et ce qui semble devenir un motif essentiel depuis une dizaine d’années « le renoncement géographique ».
A ce propos, les syndicats SNES-FSU et l’UNSA tirent la sonnette d’alarme : « Dans les académies de Nantes, Toulouse, Montpellier et Strasbourg, les postes sont pourvus car des centaines d’enseignants déjà en poste ailleurs attendent leur mutation dans ces régions attractives. Mais on déshabille Pierre pour habiller Paul dans les académies de Créteil, Versailles ou en Guyane, la pénurie augmente chaque année. En région parisienne, on voit même des candidats admis qui renoncent à leur affectation ».
La réponse de l’Education nationale à cette pénurie n’est pas satisfaisante : les académies où les chefs d’établissements ont consigne de recruter des contractuels. Avec quelle garantie de compétences académiques, quelle formation à la pédagogie ? « C’est la roulette : on peut dénicher un ou une future très bon prof et à l’inverse tomber sur quelqu’un qui n’est pas du tout calibré pour le métier ou pire va nous lâcher au bout de 2 semaines » souligne dans Le Figaro un principal de collège membre du Syndicat National des Personnels de Direction de l’Education Nationale (SNPDEN). Parmi ces contractuels certains confient au journal Le Monde avoir été balancés dans une classe « après 15 jours de formation théorique et 3 semaines de binôme. Tout ça pour un salaire net qui correspond à SMIC +10% ».
La revalorisation des salaires, en milieu de carrière notamment, est un préalable à toute initiative pour redonner de l’attractivité aux métiers de l’école. C’est le premier chantier à ouvrir. Selon l’OCDE, à l’exception notable des professeurs de classes préparatoires, un enseignant en France gagne 10% à 15% de moins que ses collègues de 20 pays comparables. L’écart avec l’Allemagne varie de près de 50%, ces derniers étant néanmoins soumis à davantage de présence obligatoire dans l’établissement et bénéficiant de 4 semaines de vacances en moins.
Deuxième chantier, la formation des maîtres. Mieux vaut-il devenir professeur avec un concours fondé sur un enseignement théorique à bac+5 ou avec un bac+3 suivi d’une vraie formation rémunérée pendant deux ans ? Universitaires et pédagogues plaident pour un retour à un encadrement prolongé du futur enseignant et un lien direct avec le territoire dans lequel ils enseigneront. Certaines universités comme l’Université Jean Jaurès à Toulouse ont saisi cet enjeu territorial et projettent de décentraliser les filières des métiers de l’enseignement dans tous les départements de l’Académie de Toulouse.
Troisième chantier, la protection et la reconnaissance. En 2023 et 2024, Samuel Paty et Dominique Bernard sont morts, assassinés par des adeptes d’idéologies obscurantistes. Morts parce que profs. Morts pour avoir expliqué la liberté d’expression à leurs élèves En 2025, Caroline Grandjean, 42 ans, professeur des écoles dans le Cantal, s’est donné la mort après avoir été harcelée pour son orientation sexuelle. La République a failli dans la protection de celles et ceux qui transmettent le savoir, qui permettent aux jeunes de s’émanciper, qui au quotidien enseignent les valeurs de la République.
Être professeur, c’est déjà faire l’expérience d’une grande solitude : chaque jour, on franchit la porte de sa classe seul, face aux élèves. Aujourd’hui, trop de professeurs se sentent isolés, trop de jeunes motivés renoncent à ce métier. Qui aurait envie d’exercer ce métier quand l’institution ne reconnait pas la valeur de son travail, ne lui donne pas les clés pour s’épanouir dans son métier, ne le met pas à l’abri des dérives de nos sociétés ?
Demain l’école doit redevenir la priorité de l’action politique. Pour que chaque élève trouve devant lui des enseignants formés, motivés, rémunérés à la hauteur de nos engagements.
L’équipe de La République en Commun